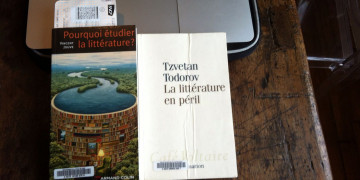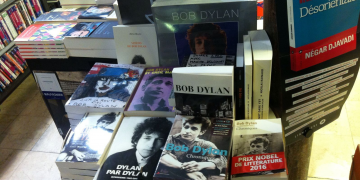« Les sommeils profonds viennent chercher des substances qui imprègnent la tête d’enduits si durs que, pour éveiller le dormeur, sa propre volonté est obligée, même dans un matin d’or, de frapper à grands coups de hache, comme un jeune Siegfried. » (Marcel Proust, À la recherche du temps perdu).
Avec la fin du semestre, la fatigue accumulée et le froid de mon appartement chauffé à l’électricité (autant dire pas chauffé), j’ai de plus en plus de mal à me lever le matin.
Bizarrement, comme en un effet collatéral du froid, je trouve les sommeils d’hivers beaucoup plus profonds que les nuits d’été, comme si « les puissances végétatives » que Proust compare « aux nymphes qui nourrissaient Hercule« , redoublaient d’activité en-dessous d’une certaine température. C’est exactement le type de sommeils de plomb dont Proust remotive la signification:
« Il semble qu’on soit devenu soi-même, pendant quelques instants après qu’un tel sommeil a cessé, un simple bonhomme de plomb. On n’est plus personne. Comment, alors, cherchant sa pensée, sa personnalité comme on cherche un objet perdu, finit-on par retrouver son propre moi plutôt que tout autre? Pourquoi, quand on se remet à penser, n’est-ce pas alors une autre personnalité que l’antérieure qui s’incarne en nous? On ne voit pas ce qui dicte le choix et pourquoi, entre les millions d’êtres humains qu’on pourrait être, c’est sur celui qu’on était la veille qu’on met juste la main. Qu’est-ce qui nous guide, quand il y a eu vraiment interruption (soit que le sommeil ait été complet, ou les rêves, entièrement différents de nous)? »
Dans ce type de sommeils, j’ai l’impression de ne plus faire ni rêves ni cauchemars, rien à voir avec tous ces songes que décrit le narrateur de la Recherche, par exemple celui où ses parents morts, transformés en petites souris à boutons rouges d’albums comiques, lui tiennent des discours cicéroniens.
Je me sens plus proche de sa description du tout début de la Recherche, quand le héros à moitié endormi ne sait plus à quelle époque ni dans quelle chambre il se trouve, tenant en cercle autour de lui « le fil des heures, l’ordre des années et des mondes« . Chacun de ses mouvements bouleverse les « mondes désorbités » qui tournoient dans cet espace à quatre dimensions qu’est le rêve, la quatrième étant sans doute celle du souvenir, et il traverse des siècles de civilisation, au sein d’espaces atemporels, en quelques secondes.
Cette ouverture m’a toujours fait penser au livre d’Alexandre Koyré, Du monde clos à l’univers infini, qui décrit le passage du monde clos des Anciens à l’univers infini des modernes.
Quand mon réveil sonne, j’ai aussi l’impression d’avoir été catapultée à des années lumière de moi-même, mais bizarrement, c’est toujours la même conscience de doctorante qui revient, et les globes désorbités qui se mettent à tournoyer dans ma tête sont invariablement les sous-parties et les chapitres qui m’attendent. Comme si c’était moi, Hercule, qui devait m’extirper du cocon de mon lit pour aller retrouver l’univers infini de ma thèse.
À quand les salles de sieste à la BNF ?
Bizarrement, comme en un effet collatéral du froid, je trouve les sommeils d’hivers beaucoup plus profonds que les nuits d’été, comme si « les puissances végétatives » que Proust compare « aux nymphes qui nourrissaient Hercule« , redoublaient d’activité en-dessous d’une certaine température. C’est exactement le type de sommeils de plomb dont Proust remotive la signification:
« Il semble qu’on soit devenu soi-même, pendant quelques instants après qu’un tel sommeil a cessé, un simple bonhomme de plomb. On n’est plus personne. Comment, alors, cherchant sa pensée, sa personnalité comme on cherche un objet perdu, finit-on par retrouver son propre moi plutôt que tout autre? Pourquoi, quand on se remet à penser, n’est-ce pas alors une autre personnalité que l’antérieure qui s’incarne en nous? On ne voit pas ce qui dicte le choix et pourquoi, entre les millions d’êtres humains qu’on pourrait être, c’est sur celui qu’on était la veille qu’on met juste la main. Qu’est-ce qui nous guide, quand il y a eu vraiment interruption (soit que le sommeil ait été complet, ou les rêves, entièrement différents de nous)? »
Dans ce type de sommeils, j’ai l’impression de ne plus faire ni rêves ni cauchemars, rien à voir avec tous ces songes que décrit le narrateur de la Recherche, par exemple celui où ses parents morts, transformés en petites souris à boutons rouges d’albums comiques, lui tiennent des discours cicéroniens.
Je me sens plus proche de sa description du tout début de la Recherche, quand le héros à moitié endormi ne sait plus à quelle époque ni dans quelle chambre il se trouve, tenant en cercle autour de lui « le fil des heures, l’ordre des années et des mondes« . Chacun de ses mouvements bouleverse les « mondes désorbités » qui tournoient dans cet espace à quatre dimensions qu’est le rêve, la quatrième étant sans doute celle du souvenir, et il traverse des siècles de civilisation, au sein d’espaces atemporels, en quelques secondes.
Cette ouverture m’a toujours fait penser au livre d’Alexandre Koyré, Du monde clos à l’univers infini, qui décrit le passage du monde clos des Anciens à l’univers infini des modernes.
Quand mon réveil sonne, j’ai aussi l’impression d’avoir été catapultée à des années lumière de moi-même, mais bizarrement, c’est toujours la même conscience de doctorante qui revient, et les globes désorbités qui se mettent à tournoyer dans ma tête sont invariablement les sous-parties et les chapitres qui m’attendent. Comme si c’était moi, Hercule, qui devait m’extirper du cocon de mon lit pour aller retrouver l’univers infini de ma thèse.
À quand les salles de sieste à la BNF ?
A suivre.
Tous les vendredis, Le journal d’une thésarde, voir l’intégrale.
La page facebook de Des Mots de Minuit. Abonnez-vous pour être alerté de toutes les nouvelles publications.
@desmotsdeminuit
Articles Liés
- Lettres ou ne pas être #7: cinéma
On ne naît pas thésard, et on s'étonne souvent de l'être devenu… Un choix de…
- Lettres ou ne pas être #13: lapin
On ne naît pas thésard, et on s'étonne souvent de l'être devenu… Un choix de…
- Lettres ou ne pas être #16: folie
On ne naît pas thésard, et on s'étonne souvent de l'être devenu… Un choix de…
Lettres ou ne pas être #114: gratuité
23/12/2016Lettres ou ne pas être #112: Rentrée
30/09/2016
Laisser une réponse Annuler la réponse
-
« Hollywood, ville mirage » de Joseph Kessel: dans la jungle hollywoodienne
29/06/202049280Tandis que l’auteur du Lion fait une entrée très remarquée dans la ...