
Qu’est-ce qui rend si actuelle la lecture d’À la recherche du temps perdu ? Pourquoi ce classique entre tous reste-t-il la meilleure école pour déchiffrer nos quotidiens ? « À la lecture », composé à quatre mains par Véronique Aubouy et Mathieu Riboulet, réécrit la Recherche aux couleurs de nos lectures et de nos identités contemporaines. Un vrai bonheur pour les proustiens comme pour les autres.
Écrit à mi-parcours, À la lecture est en partie le fruit du hasard. Un jour qu’elle rencontre un fleuriste impromptu et très proustien dans un magasin de carrelages du boulevard Saint-Germain, Véronique Aubouy s’émerveille de l’omniprésence de Proust dans nos vies quotidiennes. Pour mener à bien le projet de livre qui deviendra À la lecture, la réalisatrice pense à Mathieu Riboulet, grand lecteur de Proust et auteur des Œuvres de miséricorde, un texte magnifique qui montre la prégnance de l’Histoire et de l’art, notamment la peinture, dans nos amours et nos angoisses quotidiennes. Sans plan concerté, Véronique Aubouy et Mathieu Riboulet se lancent dans l’écriture et il en résulte un objet littéraire hors normes, où les voix et les points de vue sur Proust se succèdent en établissant des échos et des effets de sens passionnants.
Une ode à la lecture
Véritable ode à la littérature, ce récit nous raconte des histoires de lecteurs dont Proust a traversé un jour la vie. Le texte s’ouvre sur l’image d’Apolline, une jeune cavalière de 18 ans qui parcourt la Mongolie avec plusieurs amis, et surtout avec les 2408 pages de Proust. S’ensuivent des lectures solitaires ou en couple, des lectures jouissives avec Arlette, la femme de ménage qui proposera, au terme de ses efforts, la lecture à haute voix la plus pure jamais entendue par Véronique Aubouy, ou des lectures plus douloureuses qui font affleurer des souvenirs et des deuils oubliés.
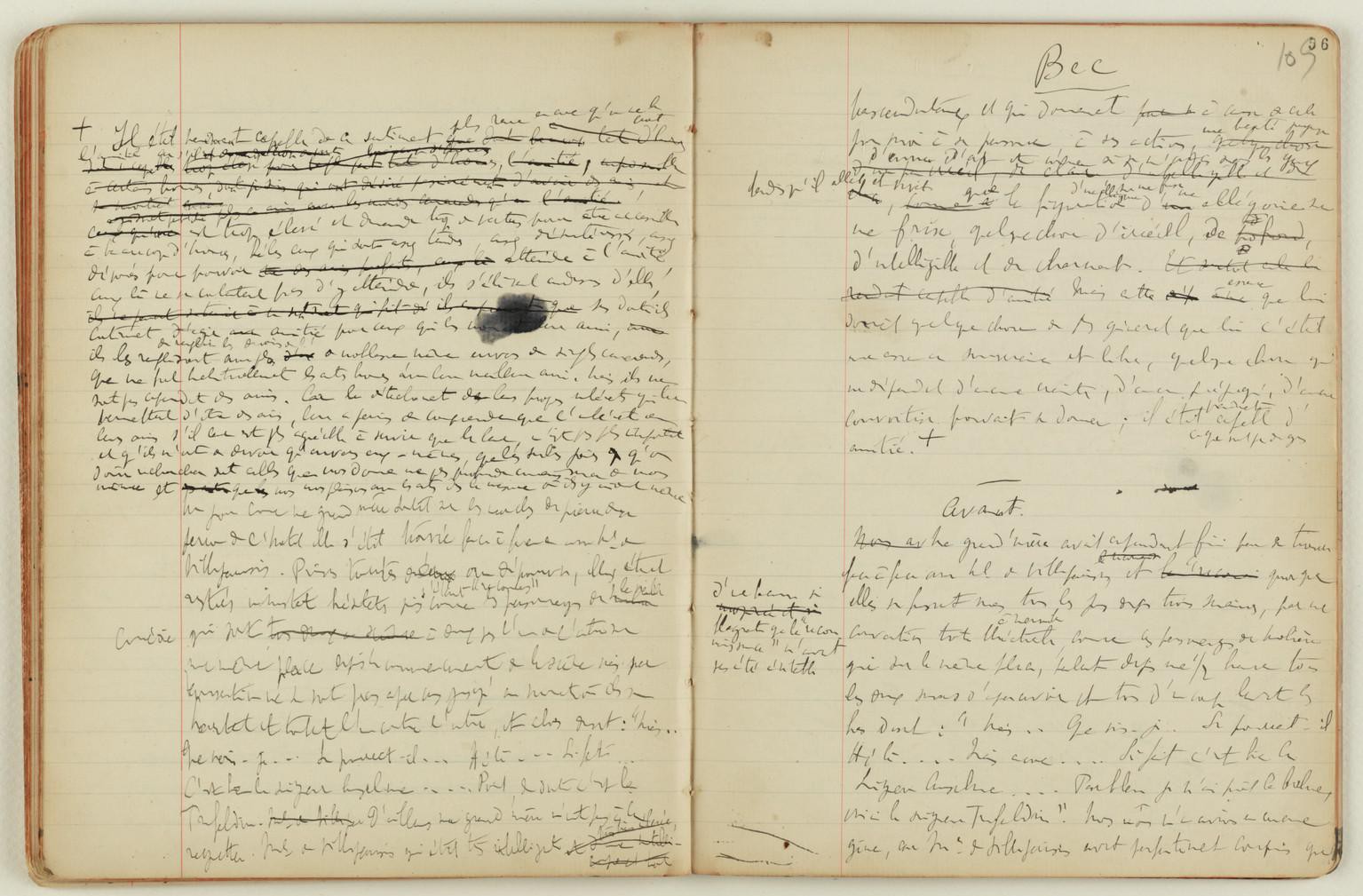
Certains chapitres évoquent des lectures filmées par Véronique Aubouy, non pas tant pour les contextualiser que comme prétexte à une rêverie sur l’impact que la littérature peut avoir dans nos vies. La réalisatrice compare souvent ces lectures filmées à des séances de psychanalyse qui révèlent le sujet à lui-même et à celui qui l’observe derrière la caméra, comme avec des verres grossissants. Les lapsus de cet homme qui ne parvient pas à lire « ma mère » et répètera deux fois « ma grand-mère« , les absences de Charles, ce lecteur tout juste sorti du coma, sont autant de symptômes que révèle « l’appareil à radiographier » tenu par la réalisatrice-analyste. Mais comme le souligne Véronique Aubouy, l’appareil à radiographier finit toujours par se retourner contre celui qui l’utilise: l’aliénation dans l’analyse des autres finit par ramener à la connaissance de soi. À la lecture présente ainsi en filigrane un double témoignage autobiographique, celui de deux artistes que réunit une certitude: Proust n’a pas fini de nous parler de ce que nous sommes aujourd’hui.
Proust aujourd’hui
Dans leur livre, Mathieu Riboulet et Véronique Aubouy présentent À la recherche du temps perdu comme le Livre avec une majuscule, « le grimoire sacré« , en un mot la Bible qui donne des instruments de mesure pour s’analyser et pour essayer de vivre mieux. Pour Mathieu Riboulet, qui relit Proust tous les dix ans environ, depuis ses dix-huit ans, chaque lecture fait affleurer l’une des strates du mille-feuilles qui nous constitue, en approfondissant la connaissance de soi. Les auteurs comparent le roman à « un champignon hallucinogène« , à du LSD qui ouvre l’accès à une autre vie, plus riche, à « la vraie vie enfin découverte et éclaircie » comme dirait Proust. Pour certains, la lecture est même « une bouée de sauvetage« : c’est le cas de l’écrivain Michel Schneider, que Proust sauva de l’endoctrinement et du sectarisme vers lequel il glissait, ou de Radovka, cette lectrice qui consacra sa vie à traduire la Recherche, préférant divorcer et ne jamais se remarier plutôt que perdre un temps précieux que Proust suffisait à combler.
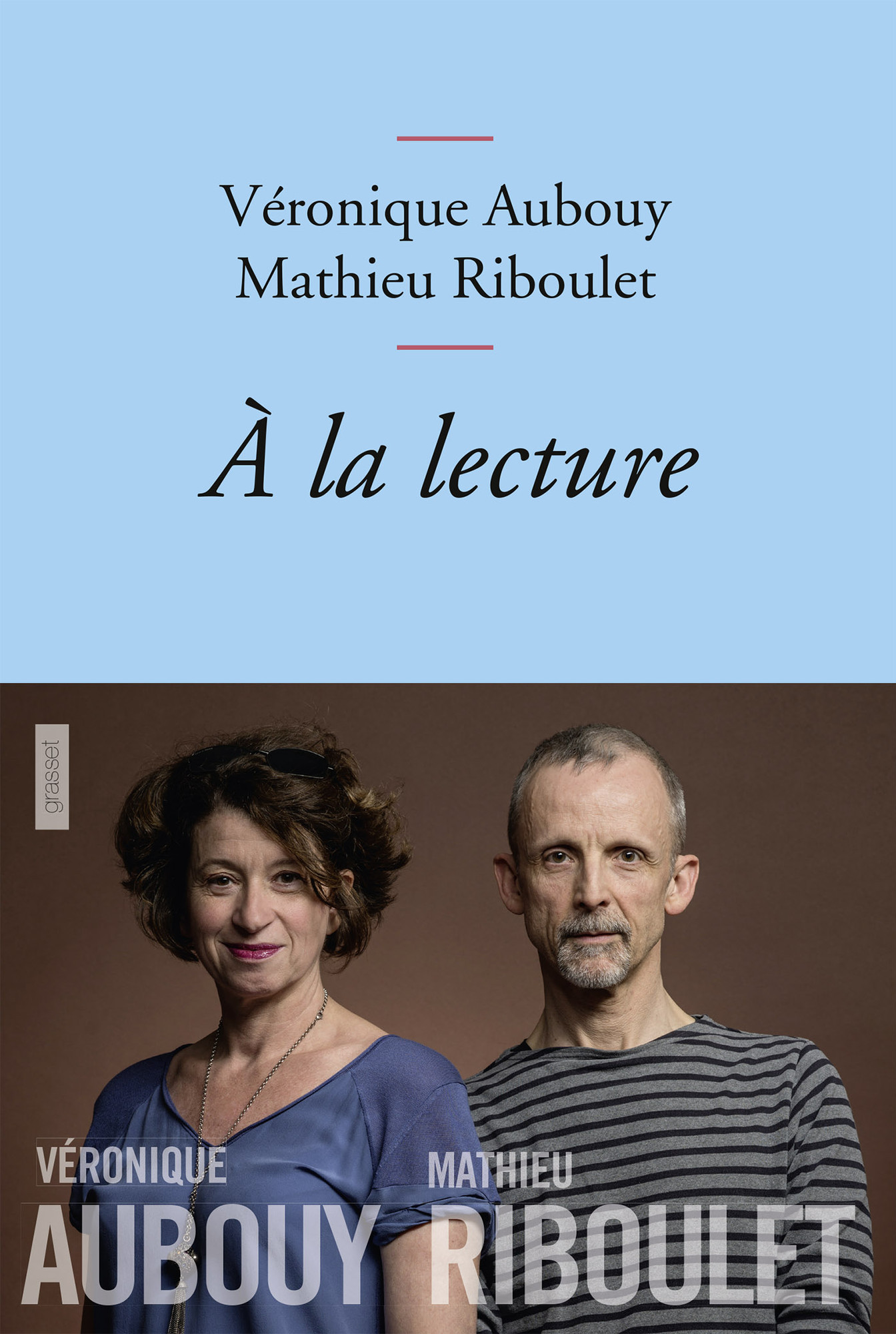
En 240 pages, les auteurs réussissent enfin la gageure de réécrire toutes les scènes-clés de la Recherche, avec un humour et une virtuosité qui donneraient presque l’impression que Proust n’est finalement pas un modèle aussi écrasant qu’on l’a dit. Le chapitre « Gender Party » propose une réécriture dans le 11ème arrondissement de Paris et à l’heure du mariage pour tous de la première partie de Sodome et Gomorrhe: une femme-homme cachée derrière sa fenêtre observe des hommes-femmes dont les parades nuptiales semblent « le prologue de quelque fête inconnue« , comme celle de Jupien et Charlus dont le héros ne voit que les prémisses… Au « registre des laitières« , on trouve ce désir soudain et brutal d’un intellectuel pour un homme du peuple qui croise son chemin, comme les vendeuses de café au lait ou les paysannes très baudelairiennes qui échappent toujours à Marcel. Les jeunes filles en fleurs, voilées, se promènent gaiement à Baalbec ou s’enlacent dans un cinéma, Albertine sort d’un ascenseur et le fier nom de Charlus est allègrement écorché par des bouches roturières. Déplacé en Turquie, le bordel de Jupien conserve sa force de subversion érotique, et le Bal des Têtes « qui dévissent » continue à gâcher les soirées entre amis. D’un chapitre à l’autre, on retrouve et on oublie les traces de la Recherche.
Loin de tous les travaux universitaires réservés à un public d’initiés, À la lecture montre que les lecteurs de la Recherche n’ont pas fini d’actualiser Proust en l’important dans nos vies quotidiennes, pour mieux le réécrire en créant des formes inédites.
À la lecture – Véronique Aubouy et Mathieu Riboulet – Grasset
La critique Littéraire desmotsdeminuit.fr
La page facebook des mots de minuit, une suite… Abonnez-vous pour être alerté de toutes les nouvelles publications.
@desmotsdeminuit
Articles Liés
- Lettres ou ne pas être #34: Paris Proust
"Si l'habitude est une seconde nature, elle nous empêche de connaître la première dont elle…
- Les Carnets d'ailleurs de Marco & Paula #119: Fabriqués des mêmes matériaux
Il y a une expression en américain qui pourrait se traduire par quelque chose comme…
- La grâce de "Bakhita", de Véronique Olmi
Véronique Olmi glisse ses pas dans ceux de la première religieuse soudanaise canonisée par Jean…
-
« Hollywood, ville mirage » de Joseph Kessel: dans la jungle hollywoodienne
29/06/202064890Tandis que l’auteur du Lion fait une entrée très remarquée dans la ...






