
Serait-ce son « âme, la noire, rien de moins » qui enfante sa littérature?
Quand je lis Claude Louis-Combet, le premier mot qui me vient pour signifier, parfois la sidération, toujours le trouble, qui vont emporter le lecteur est transport.
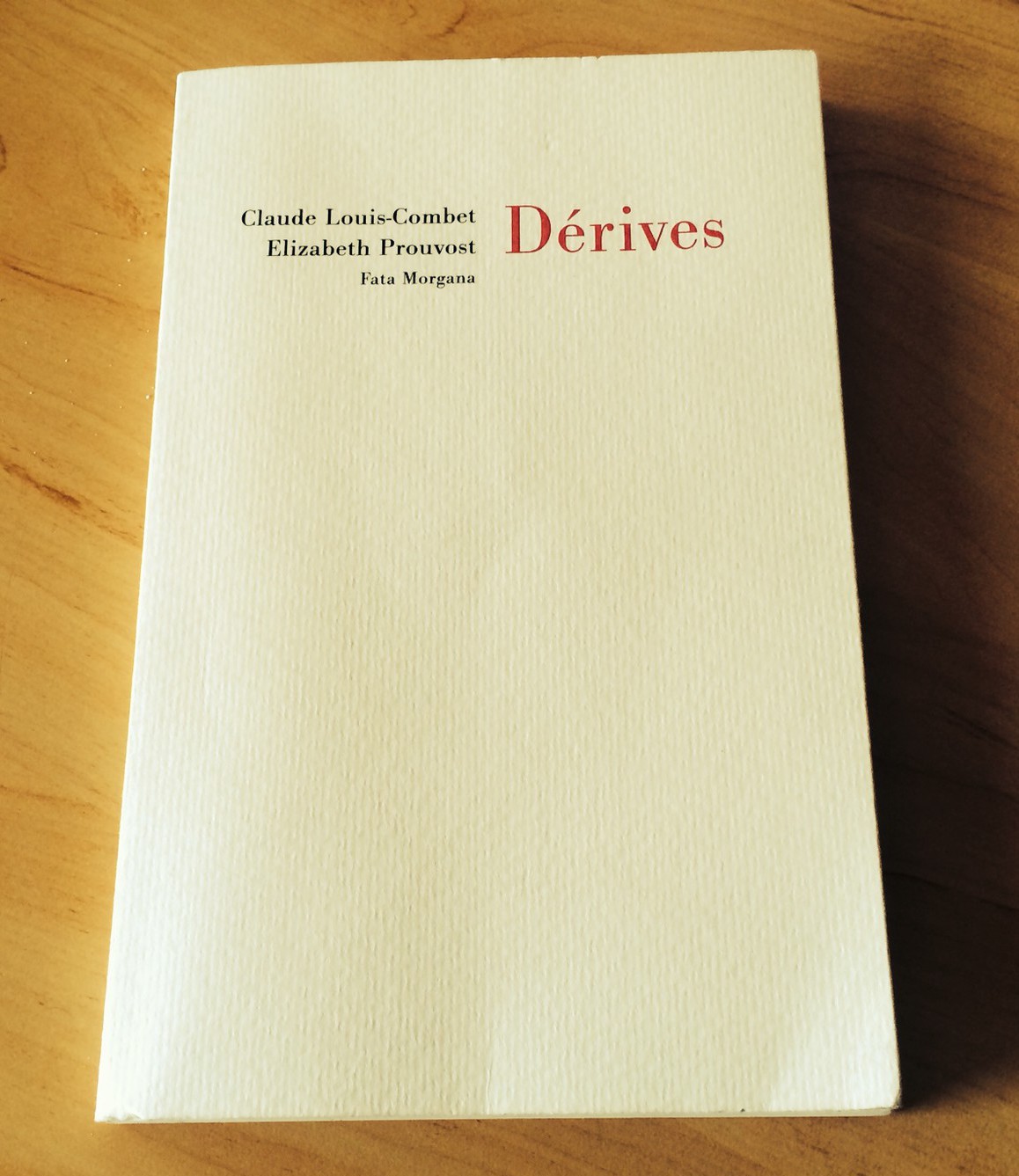

Quand il se détacha de sa mère, il avait revêtu la tunique ensanglantée, il était lié sur le brasier, son corps n’en finissait pas de se consumer, il s’arrachait, à hurler, les dernières raclures de sa gorge… »
Un jet unique.

Il pourrait y avoir du Dolto chez Claude Louis-Combet. J’y trouve plus sûrement du Rembrandt, du Fellini, du Lucian Freud, du Pasolini; une obsession en plus : L’origine du monde. Dérives a pour dernier mot : INSEPARES.
L’oeuvre raconte des histoires de mère, parfois de sœurs ou de fragiles amantes. Elle explore dans la foulée naturellement la vie des femmes mystiques du XVIIème siècle. La métaphysique, le religieux ou les fruits des entrailles ne sont jamais loin dans les « mythobiographies » de Claude Louis-Combet.
Comme si seul, un féminin hallucinatoire lui permettait d’écrire sur la douleur et l’abjection ou sur l’impossible innocence : « Et donc, elle n’était rien, elle n’était personne. Ce retirement de soi nulle part, ce désistement de tout son être, ce vide dénué de toute perspective, sans attente, sans débouché, et entièrement ramassé dans le présent d’un temps sans échappatoire, c’était cela, la solitude, l’horreur parfaitement close de l’accomplissement… Et toujours la nausée, le goût du fiel dans la bouche, l’évidence absolue qu’il n’y aurait désormais ni soin ni recours. » Dans Dérives, agonie de femme crucifiée par une foule de « liesse, de douleur et de haine ».
Plus avant, sur le Radeau de la chair, Gargamelle, monstre de foire qui « porte fente », retoque le garçon de cirque sorti de sa « vierge enfance », qui lui dévore le corps des yeux et des mains d’un tonitruant : « T’es bien trop petit, mon ami/T’es bien trop petit/dame oui ! »
Dérives. Claude Louis-Combet/Elisabeth Prouvost. Fata Morgana
©Philippe Lefait/Le Magazine Littéraire
Le + : Claude Louis-Combet était l’invité Des mots de minuit le 15 septembre 2010 avec notamment Jeannne Cherhal et Karine Tuil ……..
Le + : L’exposition d’Elisabeth Prouvost
@desmotsdeminuit
Tous les articles Lire
La page facebook des mots de minuit, une suite… Abonnez-vous pour être alerté de toutes les nouvelles publications.
@DesMotsDeMinuit
Articles Liés
- "La femme est première et absolue..." Claude Louis-Combet avec Martin Hirsch, Jeanne Cherhal, Karine Tuil #388
Incarner Emmaüs ou l'hôpital public nécessite un grand sens de l'éthique. Rare en cette période…
- Une littérature de combat...
Décembre 2013... « La parole doit être terroriste », écrit Pierre Drachline dans Pour en…
- "La femme est première et absolue..." Claude Louis-Combet avec Martin Hirsch, Jeanne Cherhal, Karine Tuil #388
Incarner Emmaüs ou l'hôpital public nécessite un grand sens de l'éthique. Rare en cette période…
-
« Hollywood, ville mirage » de Joseph Kessel: dans la jungle hollywoodienne
29/06/202050870Tandis que l’auteur du Lion fait une entrée très remarquée dans la ...






