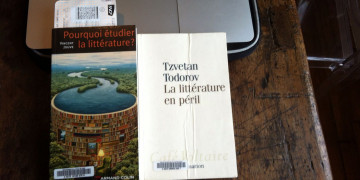C’est reparti vers le chemin de l’école – plus connectée que jamais. À quoi, au fait?
Non, je n’avais pas filé à l’anglaise,
comme semblait y inviter mon avant-dernier JDT, mais simplement (enfin!) pris trois semaines de vacances – quinze jours de plage et de soleil, sans écran et sans thèse. Avec, surprise, le plaisir retrouvé de lire quelques romans contemporains entre deux baignades, alors que je me croyais durablement dégoûtée de ce que l’Éducation Nationale qualifie à présent de « traversée langagière« , vous savez, ce très infime mouvement des yeux et du cerveau qui donne un peu mal aux épaules quand vous êtes allongé sur la plage, la lecture.
Et comme le hasard fait parfois bien les choses, il a fallu que ce soit Je m’en vais, d’Echenoz, qui m’a rappelé le bon vieux temps où m’en aller, c’était précisément ouvrir un livre. Ce temps où les petits caractères noirs qui courent d’une page à l’autre ne suscitaient en moi aucune nausée à la 4.48 Psychose, mais la douce évasion d’une autre vie infiniment découverte et éclaircie, tout ça. Bref ce temps où la littérature ne m’évoquait ni ma thèse ni mes cours mais un impératif catégorique, une érotique un peu molle mais néanmoins assez convaincue. En somme, Je m’en vais m’a ramenée à la littérature avant que Dans la foule, de Mauvignier, ne m’ouvre à nouveau l’abime solitaire des textes qu’on ne peut pas oublier: du paradoxe des livres que vous preniez pour du divertissement, et qui vous reconduisent insensiblement vers une rentrée des classes prématurée.
Et puis en cette année présidentielle, j’ai décidé de tenir mes engagements, moi aussi. Donc j’ai enfin bouclé mon calvaire de première partie, et commencé le yoga tout près de chez moi, ce qui m’a évité de commettre un assassinat sanguinaire quand mon tout nouveau MacBook Air s’est sourdement puis définitivement éteint, pile au moment où je devais terminer la rédaction de mon nouveau cours magistral, et envoyer un article que j’aurais dû finir dix jours plus tôt. J’ai passé l’après-midi avec deux commerciaux téléphonés d’une Apple Assistance dépassée, décroché un rendez-vous en urgence dans une boutique agréée par Apple, et laissé mon ordinateur en dépôt jusqu’à ce qu’un informaticien – un vrai, cette fois – me diagnostique une pièce défectueuse, d’origine. Pile au moment, en plus, où mon mari n’était pas là pendant quinze jours pour me prêter son ordinateur.
Mais là, avec toute la sérénité d’une salutation naissante au soleil, je me suis résignée. J’ai d’abord cru en Dieu et puis je suis devenue étudiante, et là j’ai donné toute ma foi et mon cœur à Steve Jobs, et j’ai acheté des ordinateurs très coûteux pour arrêter d’avoir mal à l‘épaule quand je vais travailler. Et puis j’ai vu Steve Jobs, le film, et puis mon ordinateur a planté, et là je suis devenue adulte. Non, c’est peut-être le plus triste constat de ce début d’année présidentielle: on ne peut vraiment plus croire en rien.
Heureusement, maintenant que j’ai renoncé à toute forme d’illusion, mes cours se passent de mieux en mieux. Depuis trois semaines, mes étudiants sont d’une attention et d’une motivation sidérantes, soit que ma yogatitude désabusée diffuse un calme communicatif, soit que cette nouvelle promotion se distingue par une gentillesse éclairée. Il y a bien un élève qui pourrait correspondre à ce que Sarkozy nomme « les perturbateurs » dans L’émission politique. Mais entretemps, j’ai lu Discours et Vérité de Foucault, qui rappelle l’importance de ceux que la Grèce antique nommait les « parrésiastes« , les orateurs au franc-parler qui prennent le risque de susciter la colère des puissants par leur franchise. Pour Socrate, le parrésiaste est donc l’inverse du flatteur: alors que ce dernier nous dit ce qu’on aime à entendre, le parrésiaste est le meilleur ami ou le bon citoyen qui ne craignent pas d’affronter les puissants et les institutions pour clamer haut et fort leur vérité. Au lieu de les flatter, lui seul permet au roi et finalement à la cité de se connaître, conformément à l’idéal delphique du « connais-toi toi-même« .
Et de fait, le « perturbateur » qui défend des propos proches de la théorie du complot, ou qui remet systématiquement en cause les enseignements qu’on propose, endosse à sa manière le rôle du parrésiaste. Certes, il ne risque pas sa vie, comme le conseiller du monarque qui venait critiquer sa politique. Mais devant trente ou cent étudiants, il court tout de même le risque de se faire renvoyer de l’amphi, et d’être moqué ou stigmatisé par les autres élèves. Alors maintenant, j’ai une forme de sympathie pour ces « perturbateurs« : ils sont les « parrésiastes » de notre système éducatif, qui aident notre société d’année présidentielle à se connaître.
Et puis en préparant mon cours sur la rhétorique, je suis aussi devenue moins dure avec moi-même, en ce qui concerne ce JDT. Oui il est rhétorique et j’y parle trop de moi, mais aucune confession n’a jamais rien fait d’autre qu’emprunter les chemins tortueux et les lieux éculés que lui avait légués la confluence de traditions lettrées et populaires. De Saint-Augustin à Rousseau, du confessionnal aux divans psychanalytiques, on n’est jamais rien d’autre que du langage – en ligne avec un dieu ou sur un MacBook Air à nouveau connecté.
A suivre.
Articles Liés
- Lettres ou ne pas être #18: rentrée
On ne naît pas thésard, et on s'étonne souvent de l'être devenu… Un choix de…
- Lettres ou ne pas être #70: Rentrée!
Quand je dis le mot littérature, ils ont encore les yeux qui brillent. C'est beau…
- Lettres ou ne pas être #17: érémitisme
On ne naît pas thésard, et on s'étonne souvent de l'être devenu… Un choix de…
Lettres ou ne pas être #114: gratuité
23/12/2016Lettres ou ne pas être #111: Demain?
08/07/2016
Laisser une réponse Annuler la réponse
-
« Hollywood, ville mirage » de Joseph Kessel: dans la jungle hollywoodienne
29/06/202064880Tandis que l’auteur du Lion fait une entrée très remarquée dans la ...